La grève « historique » de novembre 2025 en Belgique : trois jours de mobilisation intersectorielle
Du 24 au 26 novembre, la Belgique a vécu l’une des plus vastes mobilisations sociales de ces dernières années. Le mouvement lancé par les syndicats a successivement touché les transports publics, les services publics puis le secteur privé, jetant une lumière crue sur les tensions autour des choix budgétaires du gouvernement fédéral.
Un mouvement inédit : déroulement et ampleur des trois journées
Le coup d’envoi de la grève nationale a été donné le lundi 24 novembre avec une paralysie quasi totale des métros, trams et bus, principalement dans les grandes agglomérations. En pratique, des usagers bloqués aux arrêts ont découvert l’étendue de la détermination syndicale à mettre en avant les revendications salariales et sociales. Le lendemain, les administrations publiques ont à leur tour rejoint le mouvement, imposant la suspension de nombreux services essentiels, notamment dans les écoles et les hôpitaux publics.
Mercredi 26 on est passé à la vitesse supérieure lorsque le secteur privé s’est associé à la grève. Piquets et barrages ont pris place à l’entrée de zonings industriels, de centres commerciaux et même aux abords des aéroports, qui étaient presque à l’arrêt. Les syndicats, à l’image de la CSC liégeoise, ont salué une « grève historique » en raison de l’ampleur inédite d’une mobilisation aussi transversale.
Un contexte budgétaire sous tension : l’austérité du gouvernement Arizona
Concrètement, cette mobilisation s’inscrit dans un climat de méfiance envers le gouvernement fédéral, baptisé « Arizona » et issu d’une coalition entre la N-VA, Vooruit, le CD&V, Les Engagés et le MR. Depuis son entrée en fonction, cette majorité mène une politique d’austérité destinée à réduire significativement les dépenses publiques. Entre réformes de pensions et coupes dans les effectifs de la fonction publique, les syndicats dénoncent une « attaque organisée » contre les services publics.
À terme, le point d’orgue de ces tensions a été l’accord budgétaire conclu dans la nuit du 23 au 24 novembre. Si le gouvernement présentait ce deal comme un compromis équilibré pour respecter les engagements européens, les organisations syndicales l’ont jugé insuffisant, estimant qu’il « en remet une couche » sur les conditions de travail et le pouvoir d’achat des agents publics.
Réactions et enjeux pour les services publics et l’économie
Du côté syndical, on met en avant la nécessité de défendre un « service public fort » capable de répondre aux besoins des citoyens, de la sécurité sociale à l’éducation. Les revendications centrales portent sur le gel des réformes de pensions, l’augmentation des salaires réels et le maintien des effectifs dans la fonction publique. Pour la CGSP, ces trois jours de grève sont « plus que jamais d’actualité » tant les coupes budgétaires menacent la qualité des services rendus.
Cependant, les acteurs économiques tirent la sonnette d’alarme. La Fédération des Entreprises Wallonnes évalue à près de 100 millions d’euros par jour le coût direct de la paralysie des activités, soit environ 300 millions pour les trois journées. En pratique, les secteurs de la logistique, du commerce de détail et de l’industrie ont été fortement impactés, fragilisant la reprise économique post-pandémie et la compétitivité du pays.
Le secteur privé dans la rue : nouvelles dynamiques de la mobilisation
En intégrant désormais les entreprises privées à leur action, les syndicats belges ont franchi un cap inédit. Dans plusieurs zones industrielles, des piquets ont bloqué les entrées, obligeant les ouvriers à choisir entre poursuivre le travail ou soutenir la grève. Le message envoyé aux patrons est clair : les revendications sociales ne se limitent pas à l’administration, elles concernent aussi le monde marchand.
En pratique, cette intrusion du privé dans la grève générale a provoqué un débat sur la légitimité et le risque d’épuisement des salariés, pris entre les impératifs productifs et la solidarité classiste. Certains employés non grévistes se sont retrouvés empêchés de travailler, soulevant des questions sur la protection juridique et le droit à l’arrêt de travail dans ce cas de figure.
Quel avenir pour le dialogue social et les prochaines étapes ?
Alors que la poussière retombe, plusieurs questions restent en suspens. D’une part, le gouvernement fera-t-il des concessions pour ouvrir une véritable négociation sur les pensions et les budgets des administrations ? D’autre part, les syndicats sauront-ils maintenir la pression sans s’épuiser financièrement et sans lasser l’opinion publique face aux multiples perturbations ?
Concrètement, l’administration fédérale a déjà annoncé l’ouverture de discussions techniques en décembre, mais sans garanties de renégociation du pacte budgétaire. Les syndicats, eux, envisagent des actions ponctuelles pour prolonger la mobilisation, tout en redoutant un essoufflement chez les salariés du privé, moins habitués aux grèves qu’en secteur public.
À terme, cette grève « historique » pourrait redéfinir les rapports de force du dialogue social belge. Si le gouvernement Arizona reste sourd aux appels des travailleurs, il risque de se heurter à une défiance durable. Inversement, un geste fort en faveur d’un financement stable des services publics et d’une revalorisation des salaires permettrait de désamorcer la crise, mais au prix d’un ajustement budgétaire en contradiction avec ses engagements d’austérité.
Perspectives et leçons pour l’après-grève
Au-delà du rapport de forces immédiat, cette mobilisation pose la question du modèle social belge. Trouvera-t-on un nouvel équilibre entre les exigences financières et la préservation de l’État-providence ? Les autres pays européens suivent avec attention cette expérience belge, qui illustre la difficulté d’appliquer des plans d’austérité dans un contexte de forte contestation sociale.
En conclusion, ces trois journées de grève nationale ont mis en exergue les profondes divisions sur le rôle et le financement des services publics. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si ce mouvement aura durablement modifié les choix budgétaires du gouvernement ou s’il n’aura été qu’un coup de semonce avant un retour à l’ordre établi.
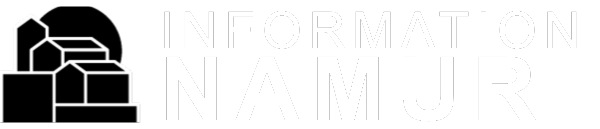











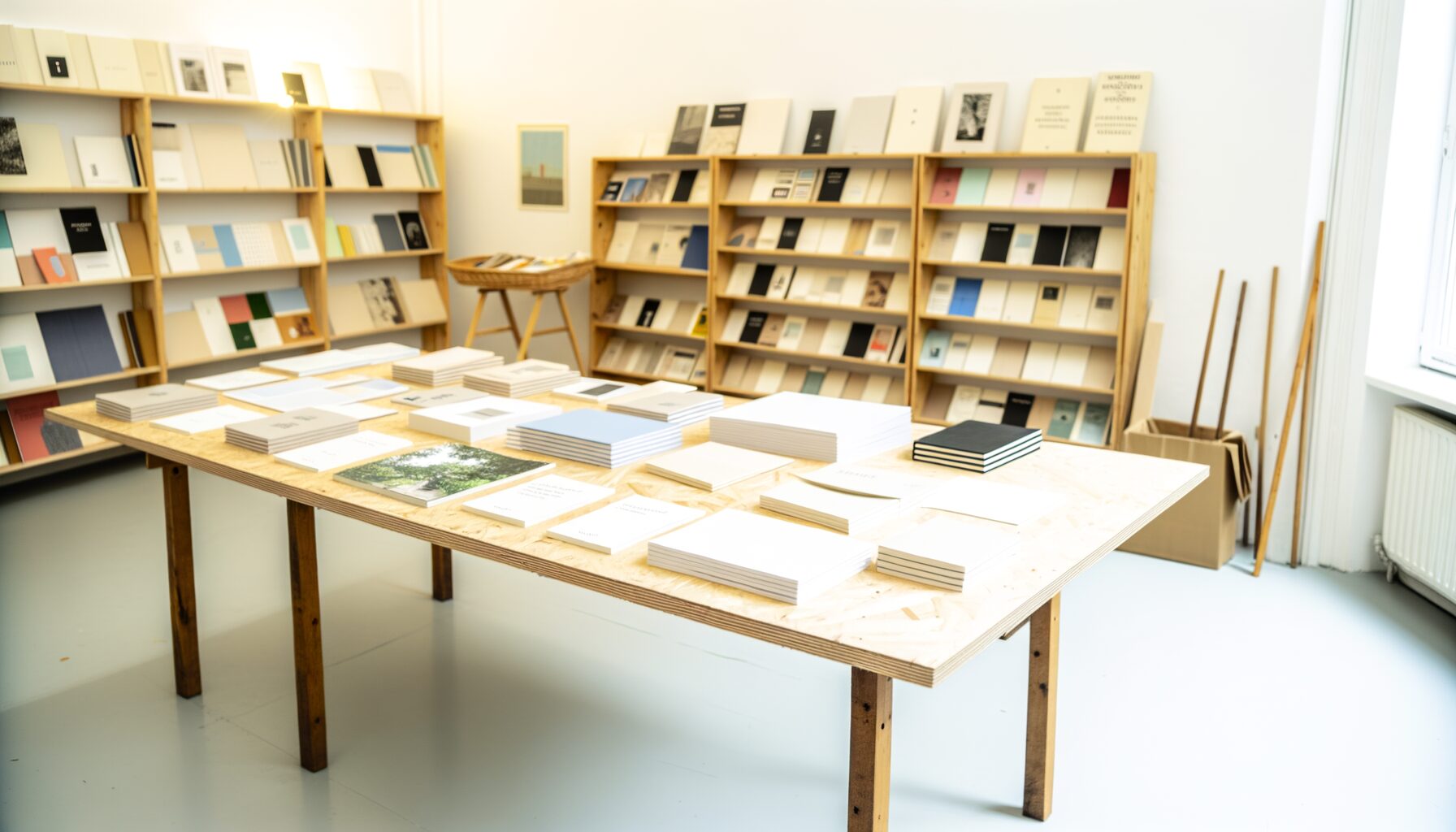









0 commentaires