Grève nationale en Belgique : le privé se met en mouvement, un choc social et économique
La Belgique est paralysée depuis le 24 novembre par une grève générale de trois jours, qui s’est intensifiée mercredi avec l’adhésion du secteur privé. Cet arrêt de travail inédit affecte aussi bien les transports, les services publics que les aéroports, soulevant une triple question : quelles sont les revendications, quels sont les coûts pour la société et quelles perspectives pour sortir de l’impasse ?
Un mouvement intersectoriel inédit
Concrètement, la grève s’est déroulée en trois vagues. Lundi 24 novembre, les chemins de fer et les transports en commun (Stib, Tec, De Lijn) ont fortement réduit leur offre, contraignant de nombreux usagers à reporter leurs déplacements. Mardi 25, ce sont les services publics – administrations, hôpitaux, écoles – qui ont rejoint le mouvement, accentuant la pression sur l’organisation du pays. Enfin, mercredi 26, le secteur privé est entré dans la danse : tous les vols passagers sont annulés tant à Brussels Airport qu’à Charleroi, les commerces, les industries et les aéroports sont à l’arrêt.
Selon les données de Brussels Airport, tous les vols au départ sont annulés et plus de la moitié des arrivées sont bloquées. À Charleroi, l’ensemble des rotations est interrompu. Ces perturbations massives témoignent de la force de mobilisation des syndicats, qui ont appelé à cette grève nationale pour contester les choix budgétaires du gouvernement fédéral.
Contexte : tensions entre syndicats et gouvernement Arizona
Depuis plusieurs mois, le climat social en Belgique est tendu. Le gouvernement dit « Arizona », coalition de cinq partis (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V et Vooruit), a présenté cet automne un plan d’économies pour réduire le déficit public. Malgré un accord budgétaire conclu dans la nuit du 23 au 24 novembre, les syndicats estiment que les mesures pénalisent la fonction publique et menacent la qualité des services essentiels.
La CGSP (syndicat socialiste des services publics) dénonce une « attaque organisée contre les services publics et en particulier la fonction publique fédérale ». Le principal point de fracture porte sur la méthode : le gouvernement préfère un ajustement comptable plutôt qu’une vraie concertation sur l’avenir de l’État social. À terme, c’est tout un modèle belge de solidarité et de protection qui est jugé en péril.
Les revendications et arguments des syndicats
Les organisations syndicales avancent plusieurs motifs pour maintenir la grève malgré l’accord budgétaire :
- Protection des services publics : garantir l’accès à des soins, une éducation et des administrations performantes, sans coupes dans les effectifs ou les budgets.
- Amélioration des conditions de travail : dénoncer la surcharge de travail et la précarisation de certains statuts au sein de la fonction publique.
- Justice fiscale : plaider pour une fiscalité plus progressive, où les « épaules les plus larges » contribueraient davantage, au lieu de rogner sur les services de première ligne.
- Dialogue social : réclamer une vraie négociation sur le long terme, plutôt que des décisions unilatérales présentées en urgence pour boucler un budget.
Pour les syndicats, cette mobilisation est un moyen de montrer leur capacité de pression et de défendre un pacte social perçu comme menacé. Les trois journées d’action illustrent l’insatisfaction profonde des travailleurs face à un gouvernement jugé sourd à leurs préoccupations.
Les contre-arguments et les coûts pour la société
En face, le gouvernement fait valoir la nécessité de rétablir l’équilibre des finances publiques. Selon lui :
- Les économies budgétaires sont indispensables pour respecter les engagements européens et maintenir la confiance des investisseurs.
- L’accord trouvé dans la nuit de dimanche à lundi témoigne d’une volonté de compromis, avec des mesures jugées équilibrées entre réduction des déficits et préservation des services.
- Les grèves massives génèrent d’importantes perturbations pour les citoyens non-grévistes, qui voient leur quotidien bouleversé (rendez-vous médicaux reportés, trafic routier saturé, annulations de vols).
- Les pertes économiques, notamment dans le secteur touristique et aérien, sont évaluées à plusieurs dizaines de millions d’euros pour ces trois jours.
Au-delà du préjudice financier, la question se pose : jusqu’où la population peut-elle tolérer des blocages à répétition sans remettre en cause l’adhésion au système social et économique ?
Enjeux financiers et sociaux
Les chiffres clés éclairent la portée de la mobilisation :
- 3 jours de grève (24, 25 et 26 novembre).
- 100 % des vols supprimés au départ et plus de 50 % à l’arrivée à Brussels Airport ; charleroise Airport à l’arrêt complet.
- 3 sociétés de transport impactées (Stib, Tec, De Lijn).
- 5 partis au gouvernement fédéral, incarnant la coalition Arizona.
À l’échelle européenne, de tels mouvements intersectoriels rappellent les grandes grèves contre l’austérité en France ou aux Pays-Bas, où la défense des services publics a cristallisé de fortes tensions. La comparaison montre que les gouvernements confrontés à des impératifs budgétaires peuvent être confrontés à une résistance sociale massive, surtout lorsque le rôle de l’État-social est jugé essentiel.
Perspectives et pistes de résolution
Au terme de cette grève, plusieurs questions restent ouvertes :
- L’accord budgétaire, perçu comme technocratique, contient-il suffisamment de garanties pour éviter de nouvelles mobilisations ?
- La concertation sociale va-t-elle être renforcée, avec l’instauration d’une table ronde pérenne entre syndicats, employeurs et gouvernement ?
- Quel sera le coût réel pour l’économie belge et comment en atténuer les effets à moyen terme ?
- Les citoyens sauront-ils distinguer les revendications légitimes des blocages abusifs, et quel impact aura cette grève sur l’image du mouvement syndical ?
En pratique, la sortie de crise passera par un dialogue approfondi. Le gouvernement devra expliquer clairement les choix budgétaires, tandis que les syndicats devront préciser leurs priorités chiffrées et le calendrier des revendications. À terme, c’est la pérennité de l’État-social belge qui est en jeu : trouver un compromis viable reste l’enjeu principal pour les deux parties.
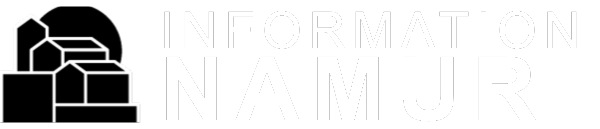











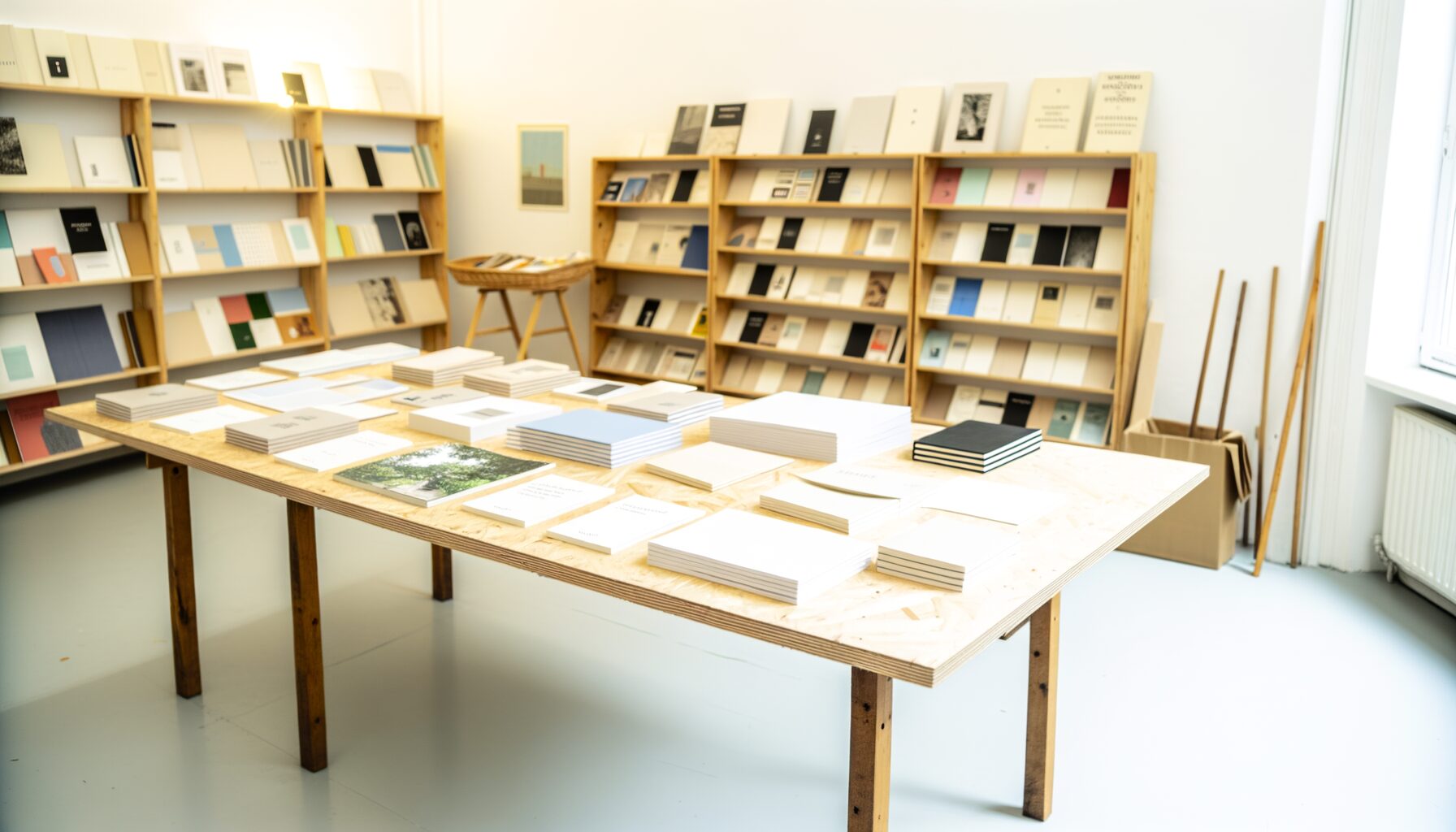









0 commentaires