Grippe aviaire H5 à Gembloux : vers un troisième foyer en Belgique
La détection de la souche H5 de la grippe aviaire dans un élevage de volailles à Gembloux relance l’alerte épidémique en Wallonie. Face à une propagation rapide du virus en Belgique et chez nos voisins, les autorités sanitaires renforcent les mesures de confinement et d’abattage pour éviter une crise majeure dans la filière avicole.
Un foyer détecté à Gembloux : faits clés et premières réactions
Le 23 novembre 2025, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a confirmé la présence du virus de la grippe aviaire H5 dans un élevage de volailles à Gembloux, dans la province de Namur. Concrètement, les quelque 5 000 oiseaux de l’exploitation seront abattus pour enrayer la propagation. À la suite de cette découverte, une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km ont été instaurées autour du site contaminé. En pratique, tous les détenteurs de volailles – professionnels comme particuliers – doivent dépister leurs animaux dans le périmètre de 10 km, et l’obligation s’étend à tous les autres oiseaux dans la zone de 3 km.
Certaines communes de la région namuroise, comme Eghezée, La Bruyère et Perwez, se retrouvent directement concernées. « Pour éviter la propagation du virus, les volailles seront abattues », rappelle l’Afsca, tandis qu’elle assure que cela limite les risques de transmission aux élevages voisins. Il s’agit déjà du troisième foyer identifié en Belgique cette semaine, après deux cas recensés dans le Limbourg.
Une épizootie récurrente : bilan en Belgique et en Europe
Depuis l’automne 2025, l’Europe connaît une recrudescence des épizooties H5, notamment en raison du retour massif d’oiseaux migrateurs porteurs du virus. En Belgique, des foyers ont été signalés dans plusieurs provinces et même de l’autre côté de la frontière néerlandaise. Les Pays-Bas ont confirmé un foyer près de Maastricht, illustrant la circulation transfrontalière du virus. En comparaison avec les épisodes de 2016-2017 ou de 2020-2021, la situation actuelle atteint un nombre record de foyers en un seul hiver.
À terme, cette dynamique place la région au cœur d’une zone à haut risque. Depuis le 23 octobre, une obligation de protection des volailles impose aux éleveurs de nourrir et abreuver leurs oiseaux à l’intérieur ou sous abri. Cependant, en pratique, tous ne disposent pas des infrastructures nécessaires, d’où des craintes sur l’efficacité de la mesure à grande échelle.
Zones de confinement et obligations sanitaires : comment ça marche ?
En aval de toute détection, l’Afsca déclenche deux niveaux de mesures. La zone de protection de 3 km vise à circonscrire le foyer initial et à contrôler strictement tout mouvement d’animaux ou de matériel. Dans cette zone, le dépistage s’applique à toutes les espèces d’oiseaux, tandis que la zone de surveillance de 10 km ne concerne que les volailles. Les éleveurs doivent déclarer tout symptôme et organiser des tests vétérinaires à leurs frais.
En parallèle, des patrouilles vétérinaires effectuent des inspections et proposent un soutien logistique pour l’élimination sécurisée des cadavres et la désinfection des locaux. « La grippe aviaire est très contagieuse et toutes les espèces d’oiseaux sont sensibles », insiste l’Afsca, soulignant l’importance d’une réaction rapide. En l’absence de vaccin autorisé pour les volailles commerciales en Belgique, la stratégie repose essentiellement sur l’abattage préventif et le confinement des oiseaux.
Conséquences économiques et sociales pour les éleveurs
L’abattage massif représente un choc pour les exploitations touchées. Les pertes directes incluent la valeur commerciale des volailles et les frais de dépeuplement et de nettoyage, qui peuvent s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euros. À cela s’ajoutent la suspension temporaire de l’activité et la perte de revenu des éleveurs. Certains petits exploitants craignent même pour la survie de leur ferme familiale.
Par ailleurs, les contraintes administratives pèsent sur les éleveurs de loisir. Nombre d’entre eux devront investir pour aménager des enclos couverts, se conformer aux dépistages et obtenir les autorisations de réintroduction d’animaux. Cette charge financière suscite des tensions au sein des filières locales, où certains producteurs demandent des aides d’État plus substantielles et un accompagnement technique renforcé.
Coordination transfrontalière et perspectives d’avenir
Face à l’extension rapide du foyer, la coopération entre la Belgique, les Pays-Bas et la France apparaît cruciale. Des réunions bilatérales sont planifiées pour harmoniser les protocoles de surveillance, partager les données épidémiologiques et envisager des mesures communes de quarantaine. En théorie, une approche concertée limite le risque de « zones refuges » où le virus pourrait se maintenir.
À plus long terme, plusieurs pistes de réflexion émergent : l’adoption de vaccins vétérinaires contre la souche H5, la rénovation des infrastructures d’élevage pour séparer totalement les oiseaux domestiques des sauvages, et la mise en place d’un réseau européen de laboratoires dédiés à la veille virologique. « Aucun cas de transmission de l’animal à l’humain n’a été observé dans le monde », insiste l’Afsca. Néanmoins, les experts recommandent de surveiller de près d’éventuelles mutations susceptibles d’accroître le risque zoonotique.
À l’aube de l’hiver, la vigilance reste de mise. Les autorités invitent tout citoyen à signaler immédiatement la découverte d’oiseaux morts en milieu naturel via le numéro gratuit 0800/99 777. Car, si la menace reste pour l’heure confinée aux oiseaux, la maîtrise rapide de la grippe aviaire constitue un enjeu majeur pour la sécurité alimentaire, la pérennité économique des élevages et la tranquillité sanitaire de nos territoires.
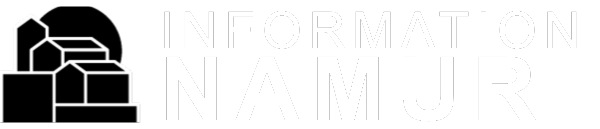











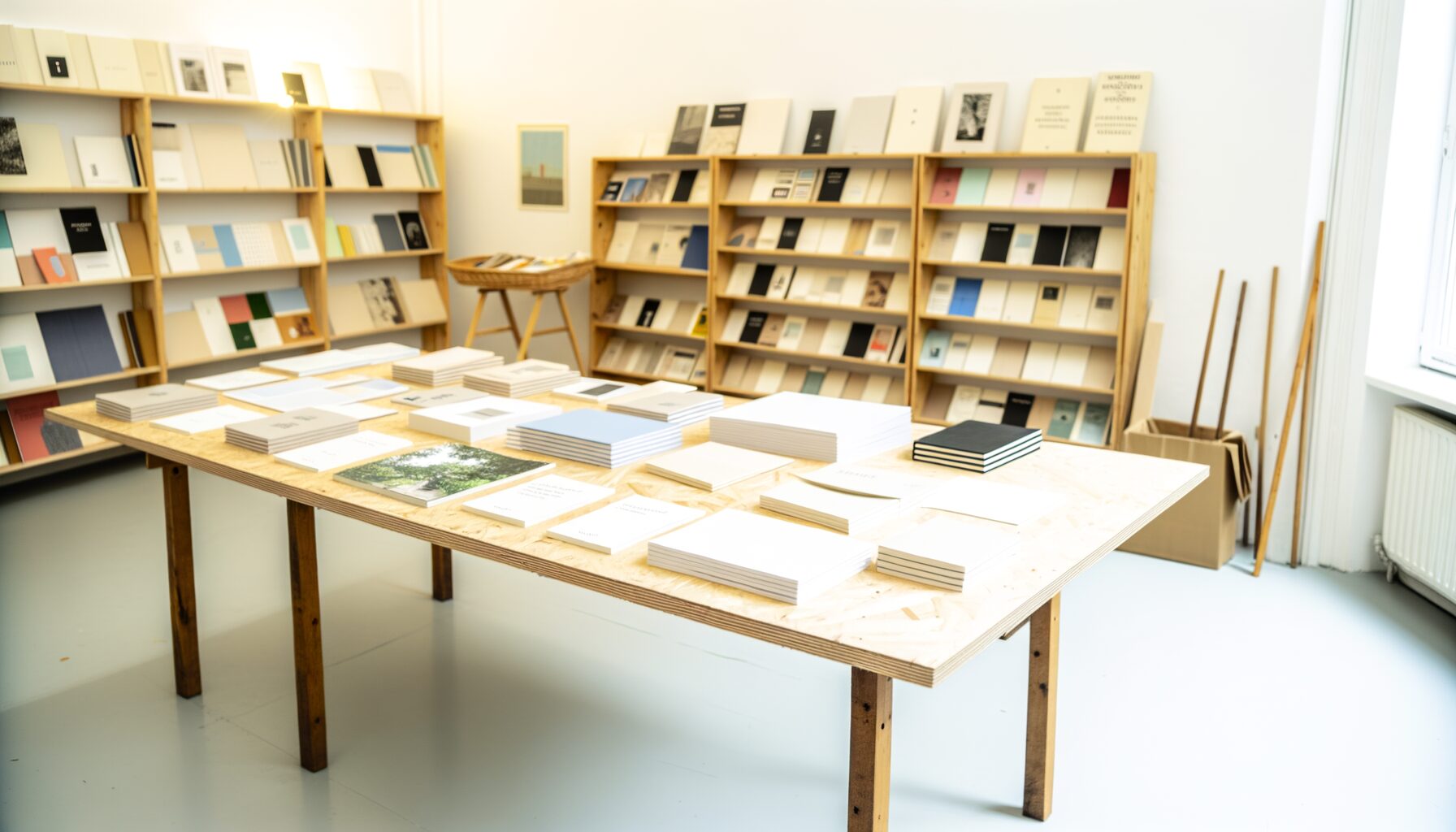









0 commentaires